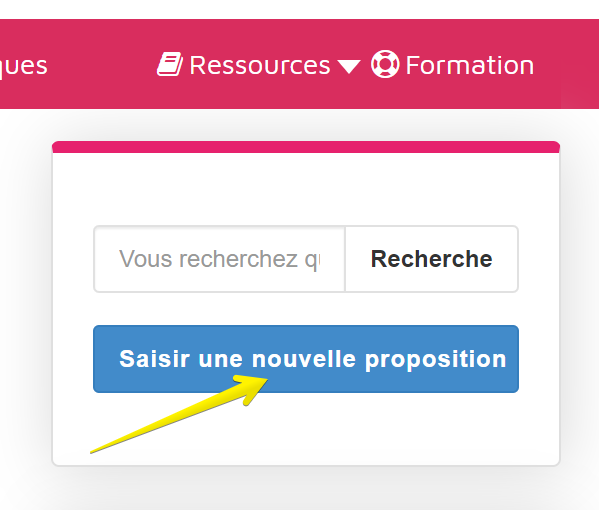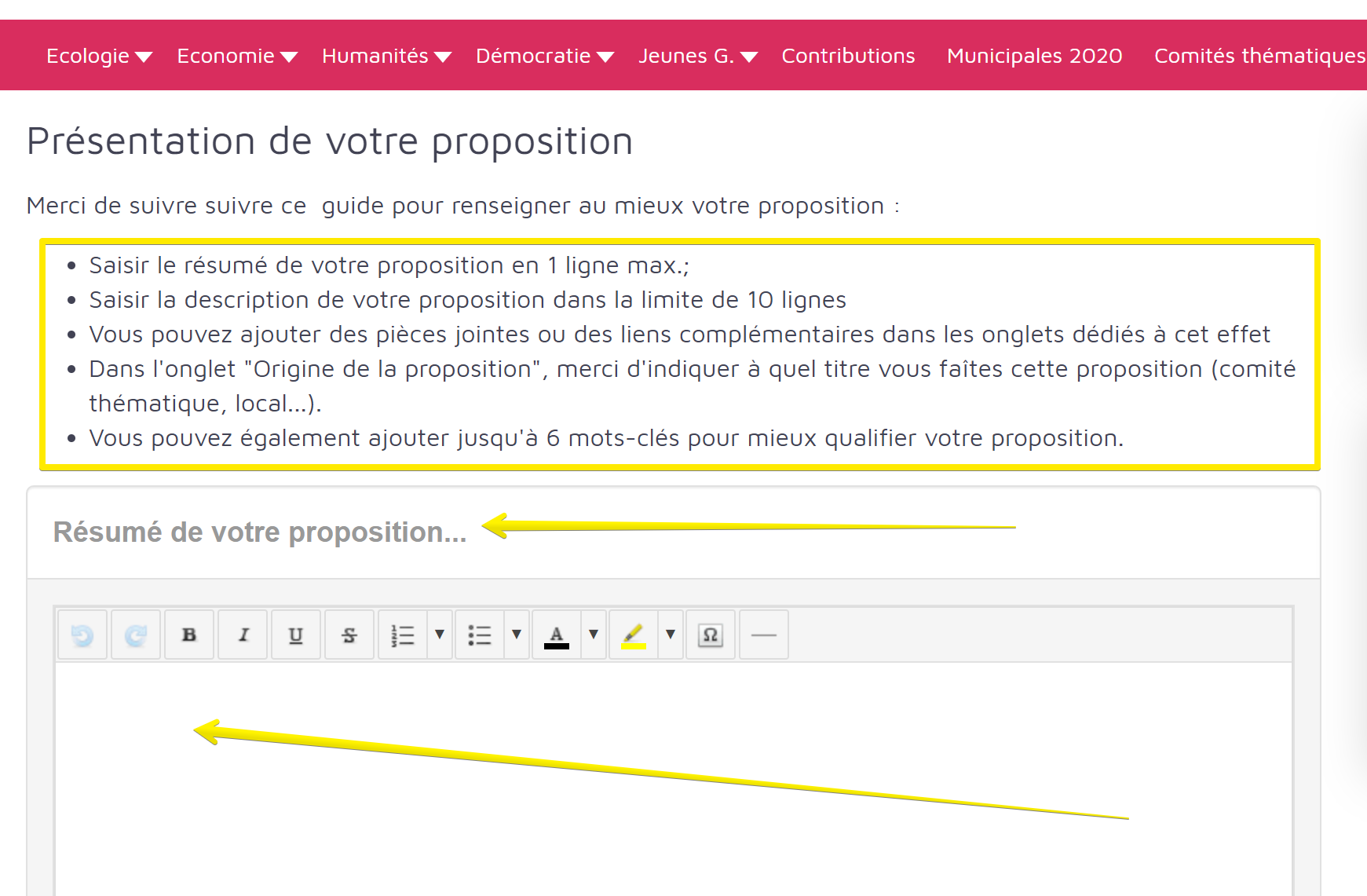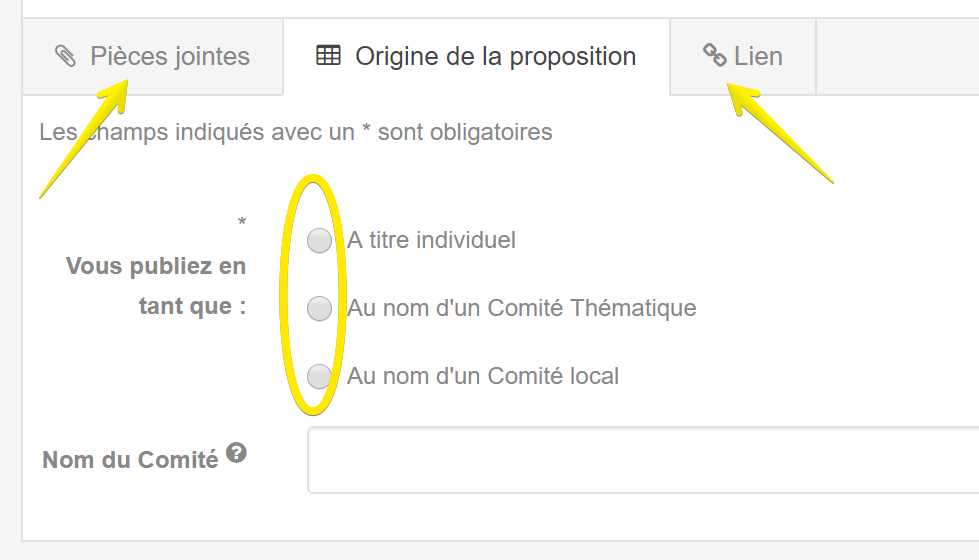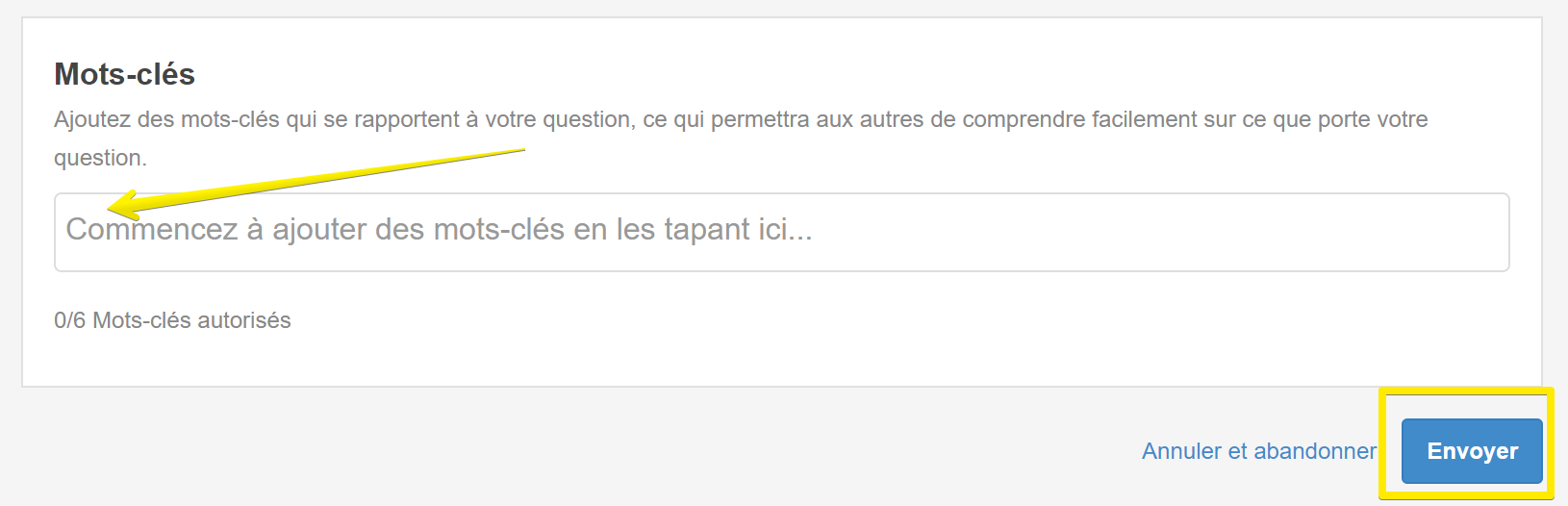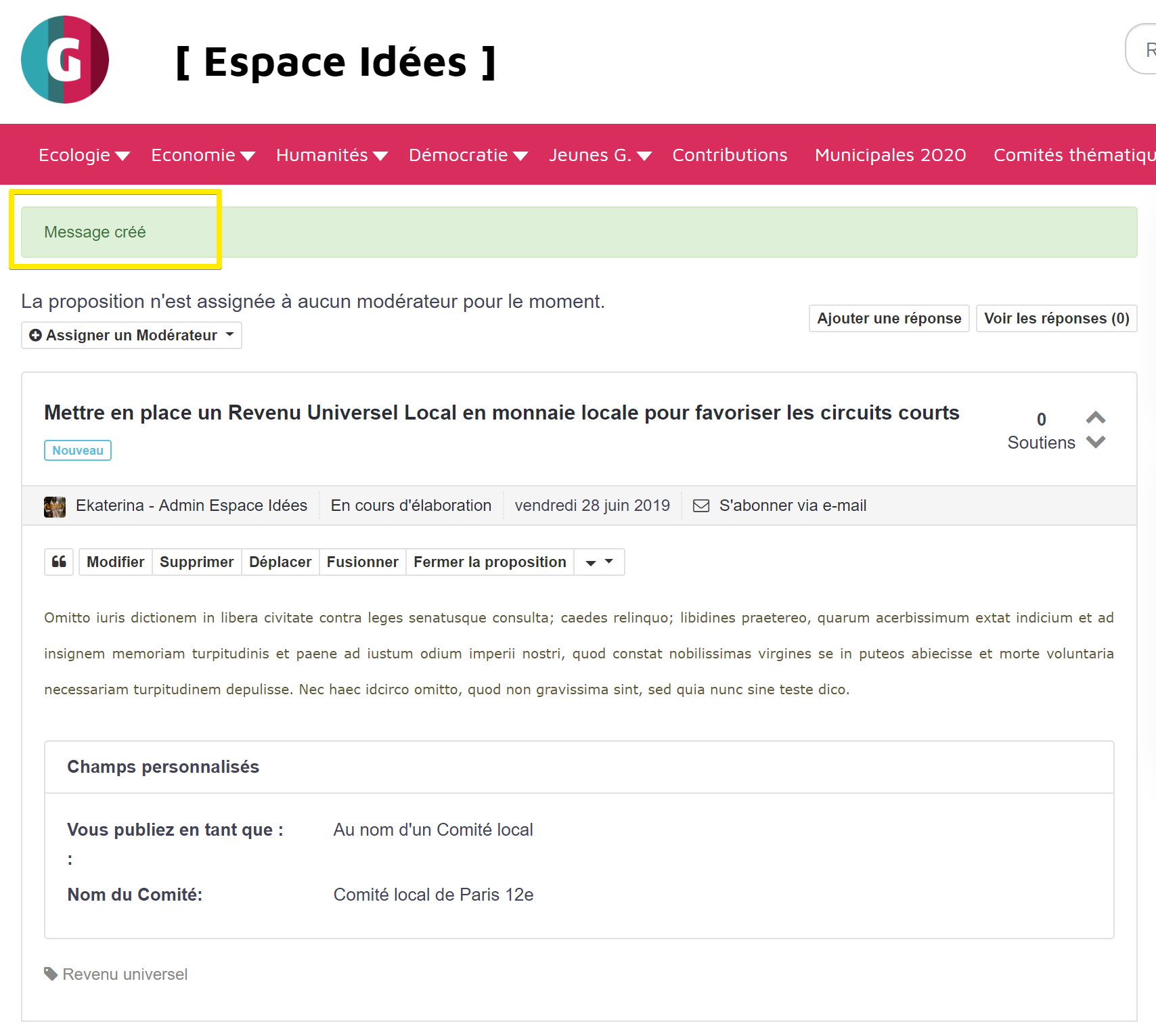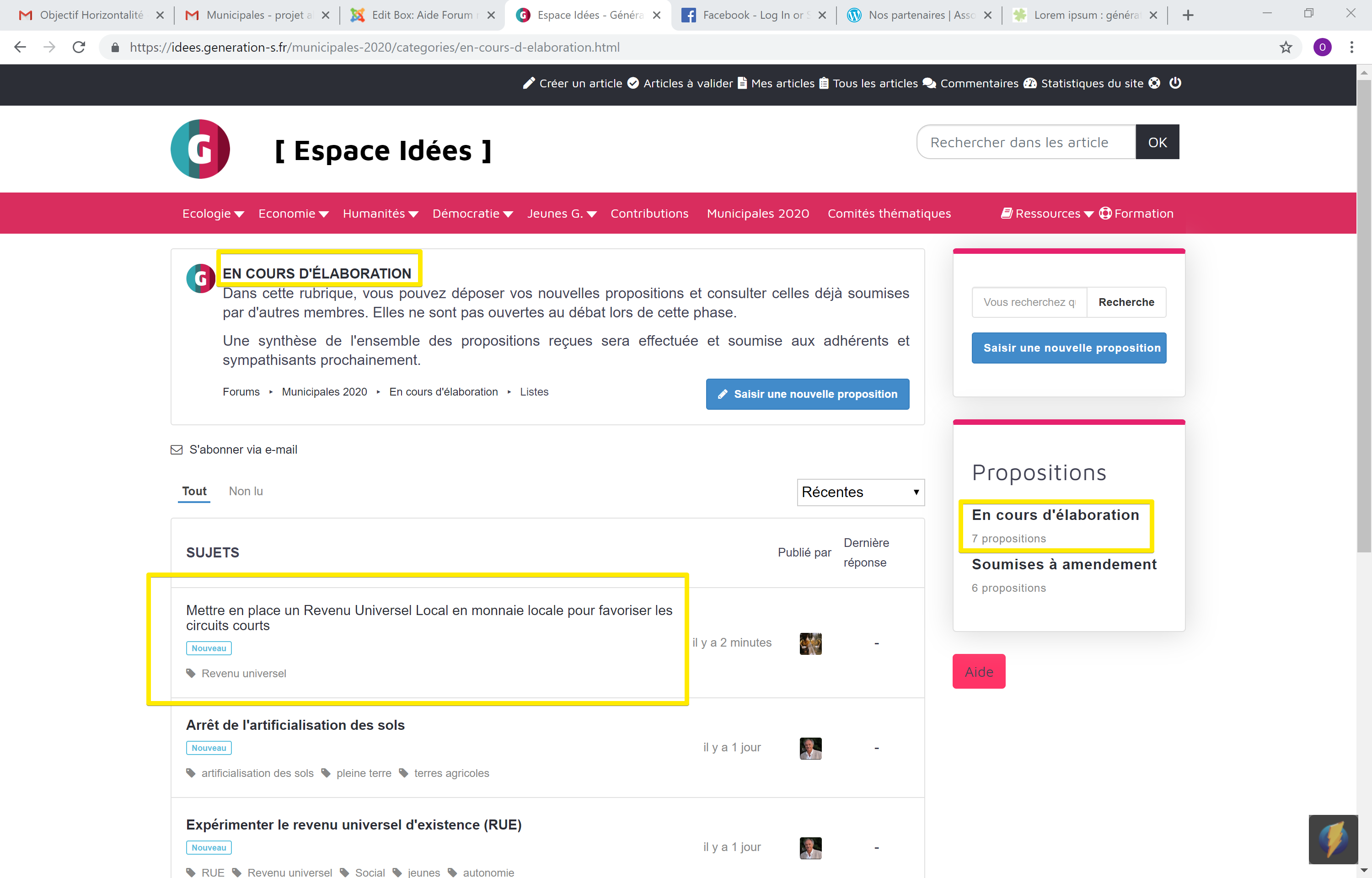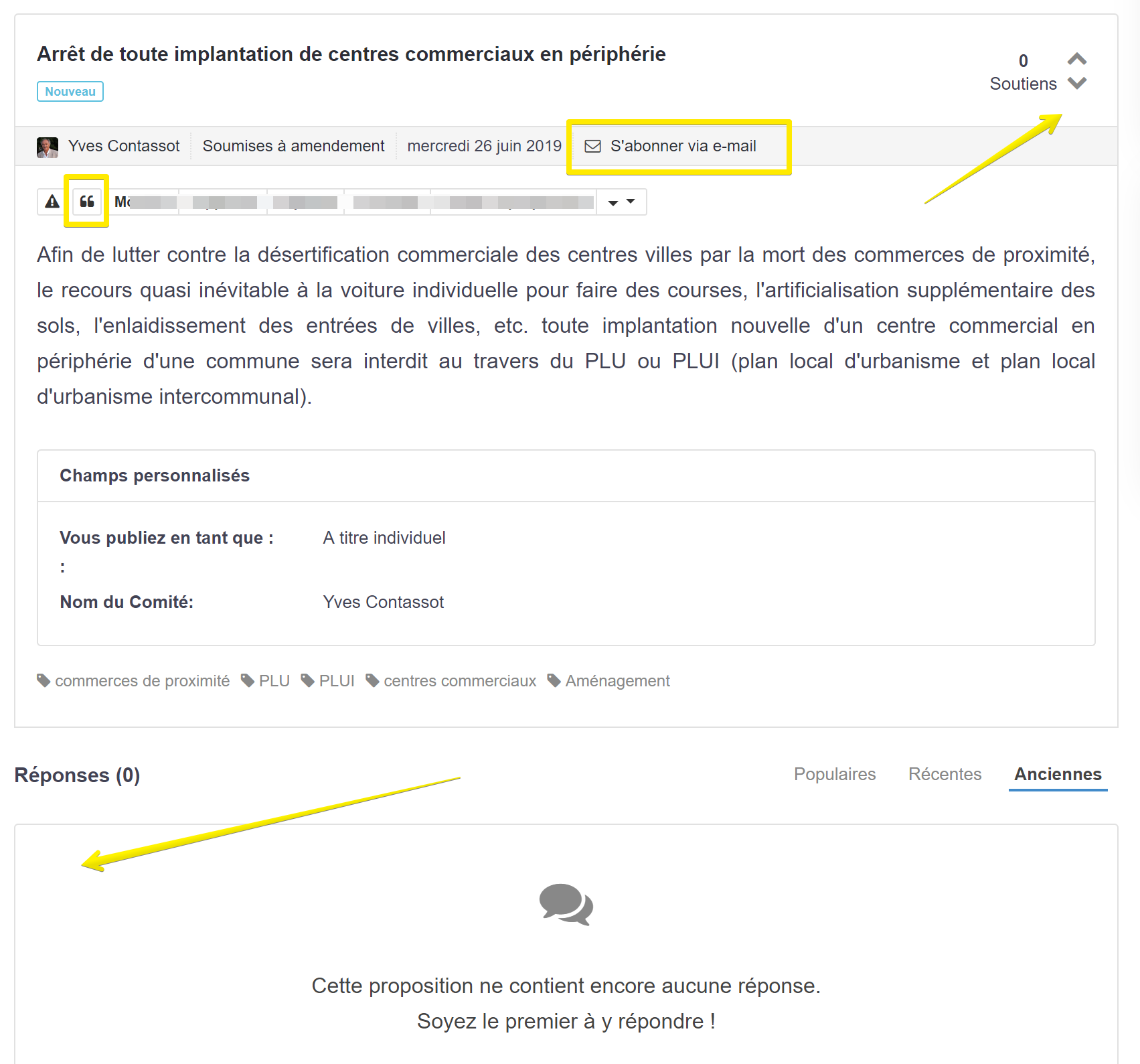Proposition
Quel modèle économique pour demain en lien avec le changement climatique ?
« La pensée originale est toujours critique, elle requiert un pas de côté par rapport aux principes mêmes d’un savoir, une disponibilité à les modifier »
(Alain Supiot Le travail au XXIè siècle Ed Sciences Po.)
Il est de tradition, à gauche, d’affirmer que le capitalisme est responsable de quasiment tous les maux que nous rencontrons sur la planète, qu’il s’agisse des inégalités sociales, des discriminations en tout genre voire même de la dégradation de la biodiversité liée en grande partie au dérèglement climatique.
Il est incontestable que le capitalisme qui repose sur l’impératif catégorique de l’accumulation sans fin de richesses, est structurellement destructeur de l’environnement (comme de la société).
Le capitalisme est intrinsèquement productiviste de deux manières :
- par la construction même du profit capitaliste : celui-ci, on le sait, est constitué par la « plus-value » ou « sur-valeur » , c’est-à-dire la part de la richesse créée par le travail qui n’est nécessaire ni à la reconstruction de la force de travail, ni à l’investissement, celle que s’approprie le ou les propriétaires du capital. Si un salarié a besoin d’une demi-journée de travail pour prolonger sa vie de salarié, la demi-journée suivante est donc du « surtravail », dont la valeur revient au capital.Sans plus -value, ni profit, ni investissements possibles.Sans plus-value, pas de capitalisme.Dès lors, l’enjeu pour les détenteurs du capital est de faire augmenter cette plus-value, donc le profit. Pour cela, plusieurs solutions s’offrent : plus faible rémunération du travail, allongement de la durée effective de travail, augmentation de la production par la mécanisation etc…
Dans tous les cas, les mécanismes du profit capitaliste induisent en eux-mêmes une augmentation de la production de manière générale.
- Par le « néo-libéralisme » à l’œuvre depuis la fin des années 1970 : la fin du compromis fordiste, essentiellement dû à une contre-offensive du capital pour récupérer une plus large part de plus-value, considérée comme trop faible depuis la fin des années 1930 ; a été rendu possible par divers outils comme la révolution numérique, l’abaissement des coûts de transports, la financiarisation des modèles économiques.
Un des principes fondamentaux de ce nouveau capitalisme est le « libre-échange », c’est-à-dire l’extension géographique des échanges marchands avec le moins de limites juridiques et sociales possibles. C’est ainsi que les grandes entreprises ont pu diversifier leur main d’œuvre en réduisant les coûts du travail par la concurrence entre travailleurs, c’est ainsi que le profit capitaliste a repris son envol dans des mesures jamais égalées jusqu’ici.
On peut donc affirmer avec force que le capitalisme est l’une des causes principales de la crise écologique actuelle.
Mais pour autant, qu’en est-il des autres formes d’organisations de l’économie et du modèle de production ?
Depuis 1917 et plus encore après 1945, un grand nombre de pays ont été soumis à un régime communiste ou socialiste. En a-t-il été différent au plan de l’impact environnemental ? A l’évidence non !
La raison principale tient au choix universel de faire de la croissance le pivot de la réussite tant économique que politique.
Car un accroissement de la croissance suppose comme corollaire une exploitation toujours plus grande des ressources physiques de la planète et une explosion de la consommation énergétique.
Ainsi entre 1970 et 2017, l’économie mondiale a extrait trois plus de ressources naturelles.
Or s’il a existé un léger découplage entre l’évolution du PIB et celle de l’énergie tout au long du XXe siècle il n’en va plus de même depuis le début des années 2000. De plus il s’est agi en réalité d’un découplage relatif : les émissions de CO2 et l’énergie que nous avons utilisée a seulement augmenté un peu moins vite que le PIB.
Les gains de productivité du travail liés à l’industrialisation (puis à l’automatisation, à l’informatisation et récemment à la robotisation) se font par remplacement (total ou partiel) de tâches humaines par des machines, qui consomment de l’énergie
Ainsi Internet représente aujourd’hui 4% des émissions mondiales de CO2 contre 2,8% pour le transport aérien civil, et sa consommation énergétique s’accroît de 9 % par an. Cette part pourrait ainsi doubler d’ici 2025 pour atteindre 8 % du total – soit la part actuelle des émissions de CO2 des voitures au niveau mondial.
Un PIB qui augmente durablement avec une énergie qui baisse durablement en valeur absolue cela n’a jamais été observé. Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’objectif de l’accord de Paris d’arriver à la neutralité carbone en 2050 est possible tout en ayant une évolution positive de la croissance.
Le productivisme qu’il repose sur le capitalisme ou une économie administrée est donc antinomique avec la lutte contre le dérèglement climatique.
C’est donc bien à cette conception qu’il faut s’attaquer de façon prioritaire si l’on veut répondre à la crise climatique et permettre aux générations futures de vivre en paix, voire de simplement pouvoir vivre sur terre.
« Si la situation ne se débloque pas, c’est parce que les mesures grâce auxquelles on aurait le plus de chances d’éviter la catastrophe (et qui profiteraient à l’immense majorité de la population) représentent une grave menace pour la minorité qui a la haute main sur l’économie, la sphère politique et la majorité des grands médias ».
Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne faille pas également combattre le capitalisme mais se contenter de cette lutte risque de faire passer au second plan l’enjeu climatique.
« Il serait faux et dangereux d’oublier que les ennemis de la société écologique font aussi partie de l’histoire même de la gauche et du socialisme dans ses orientations majoritaires, encore prégnantes ».
En effet la social-démocratie, comme les partis communistes, ont porté comme postulat que c’était grâce à l’accroissement des richesses créées qu’il était possible d’opérer une redistribution afin de réduire les inégalités.
« La caractéristique majeure de la période qui va des années 1970 aux années 2000 n’est pas l’émergence de nouvelles forces structurantes mais plutôt la désagrégation des forces antérieures. Nous entendons par là principalement, l’épuisement ou l’extinction des trois grands courants de la « vieille gauche » : le réformisme social-démocrate et progressiste dans le « premier monde » ; les dictatures communistes révolutionnaires promotrices d’un développement industriel rapide dans le « deuxième monde » ; les mouvements nationaux-populistes du tiers monde» .
Toute remise en cause de la croissance et donc du productivisme est apparue comme une posture libérale favorisant le statu quo.
Pourtant refuser l’accroissement infini de la croissance ne signifie en rien réduire le bien-être. Cela suppose néanmoins de remettre en avant des priorités, l’être plutôt que l’avoir, l’usage plutôt que la propriété.
L’évolution de la croissance dépend de plusieurs facteurs dont l’évolution de la démographie qui pèse pour environ 45% de l’évolution du taux de croissance par an depuis de nombreuses années . Envisager une simple décroissance générale n’a pas forcément de sens si l’on intègre cette donnée et si l’on considère qu’une bonne partie de la population n’a pas accès à des services essentiels. La culture, l’éducation, la formation, les soins, etc. ne peuvent subir une décroissance. En revanche lutter contre l’obsolescence programmée telle qu’elle fonctionne aujourd’hui aurait un impact important sur la consommation des biens matériels. C’est donc davantage une décroissance sélective liée à une croissance sélective qu’il faut envisager d’où le terme communément utilisé de postcroissance.
On constate une baisse de la productivité dans les économies avancées : elle passe de plus de 4% par an dans les années 50-60 à moins de 0.5% par an à partir de 2015. Elle est en constante diminution.
« Dans ces conditions le PIB par habitant (mesure conventionnelle de la prospérité) ne peut croître que si la proportion de la population active augmente ou si le nombre d’heures travaillées par chaque membre de la population active augmente. Au-delà d’un certain point, demander à plus de gens de travailler plus longtemps aura de fortes chances d’accentuer le recul de la productivité.
Il n’existe aucun scénario crédible, socialement juste et écologiquement soutenable pour faire croître en permanence les revenus de 9 milliards de personnes» .
Passer du productivisme capitaliste à un nouveau modèle impose de repenser l’ensemble du système économique dans toutes ses composantes : quelle production de biens et de service pour quelle finalité, dans quelles conditions de fabrication, dans quels territoires, pour quels usages, etc. ?
Parmi les questions essentielles figurent bien évidemment celles qui ont trait à la place relative du marché dans l’économie, la place des services publics, la gestion des biens communs, le rôle, le statut et les modalités d’intervention du secteur financier. La transition énergétique représente à elle seule un enjeu majeur sans laquelle rien ne sera possible.
A défaut d’avoir la prétention de répondre seuls à toutes ces questions, Génération.s peut néanmoins tracer quelques pistes.
Le modèle alternatif que nous avons commencé à esquisser pourrait être appelé, en reprenant la terminologie du philosophe Bernard Stiegler, l’économie « contributive », c’est-à-dire une économie qui valorise les contributions de chaque membre de la société, au-delà de la production de richesses matérielles. A l’heure de l’automation et de l’urgence écologique, il convient en effet de mieux valoriser des actions qui contribuent au bien-être de la société et de la planète, sans pour autant produire d’effet mesurable en termes de PIB : s’engager dans une association, se former, enseigner, agir pour l’environnement, s’occuper de ses enfants ou de ses parents malades...L’économie contributive permet ainsi de recentrer les priorités de la société autour de l’essentiel : l’environnement, l’éducation, la santé mais aussi les loisirs et le temps familial.
Nous avons aujourd’hui besoin d’une nouvelle matrice politique sur laquelle puisse se développer une éthique de l’émancipation tout à la fois d’intérêt individuel, sociétal et terrestre. « Dissocier l’écologie d’un positionnement politique clair sur le capitalisme, le libre-échange, la mondialisation et la finance, c’est la priver d’une ancre primordiale et prendre le risque de dérives inquiétantes » .